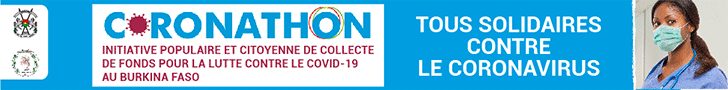Adopté le 1er septembre 2025 par l’Assemblée législative de transition (ALT), puis promulgué le 25 septembre par le chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré, le nouveau Code des personnes et de la famille (CPF) continue de susciter de vives réactions. Dre Lydia Rouamba, Maîtresse de recherche en sociologie à l’Institut des Sciences des Sociétés (INSS/CNRST), exprime dans une tribune critique sa profonde inquiétude face à certaines dispositions qu’elle juge régressives pour les droits des femmes. Elle a accepté de répondre aux questions de leFaso.net.
leFaso.net : Dre Rouamba, dans votre tribune, vous évoquez un « recul historique » du droit des femmes. Pourquoi cette formule forte ?
Dre Lydia Rouamba : Parce qu’en introduisant la possibilité pour un homme de passer d’un mariage monogamique à un mariage polygamique sans que la femme puisse réellement s’y opposer, on consacre juridiquement un pouvoir unilatéral. Cela vide de sens le principe du consentement dans le mariage, qui est pourtant au cœur de l’égalité conjugale. Il ne s’agit pas de débattre ici pour ou contre la polygamie, mais de dénoncer le fait qu’un choix de départ, le régime matrimonial, puisse être unilatéralement renié par l’un des conjoints.
Mais la polygamie n’a jamais été interdite au Burkina Faso. En quoi cette nouvelle disposition change-t-elle la donne ?
Oui, la polygamie existait et existe toujours. Mais auparavant, les futurs époux devaient opter dès le départ pour un régime : monogamique ou polygamique. Et ce choix était contraignant. Le nouveau code permet désormais à un homme de modifier ce régime en cours de mariage. Cela veut dire qu’une femme qui avait clairement exprimé sa volonté de vivre dans un couple monogame peut se retrouver, sans l’avoir choisi, dans une union polygamique. Ce n’est pas juste. C’est une brèche énorme dans la sécurité affective et juridique des femmes.
Le gouvernement avance l’argument du respect des coutumes. Que répondez-vous à cela ?
Le respect des coutumes ne doit pas se faire au détriment des droits fondamentaux. Une société qui avance ne peut pas se contenter d’accompagner toutes les pratiques sociales existantes, surtout si celles-ci reposent sur des inégalités de pouvoir. La tradition ne doit pas être une excuse pour maintenir les femmes dans une position de vulnérabilité.
Vous évoquez également un risque pour la stabilité des couples. Pouvez-vous préciser ?
Lorsqu’une femme entre dans un mariage monogamique, elle bâtit sa vie sur cette base. Modifier cette base en cours de route, sans son consentement libre et éclairé, c’est trahir un engagement. Cela peut générer des tensions, de la jalousie, du ressentiment. Et ces tensions ne s’arrêtent pas au couple.: Elles se répercutent sur les enfants, les familles élargies, voire la cohésion sociale. Dans un pays déjà fragilisé par l’insécurité, ce n’est pas un détail.
Pensez-vous que cette loi pourra être révisée à l’avenir ?
La loi est promulguée, c’est un fait. Mais cela ne signifie pas que le débat est clos. En tant que chercheure, j’estime que notre rôle est de continuer à analyser, à critiquer et à proposer. Une réforme législative n’est jamais figée. Il faut continuer à porter la voix des femmes, à documenter les conséquences sociales de cette disposition, et à plaider pour une législation réellement équitable.
Un dernier mot ?
Le droit n’est pas seulement un ensemble de règles ; il est aussi porteur de valeurs. Si nous voulons une société juste et inclusive, il faut que les lois reflètent cet engagement. Défendre les droits des femmes, ce n’est pas diviser, c’est renforcer notre tissu social. Et c’est l’affaire de toutes et tous.
Propos recueillis par leFaso.net